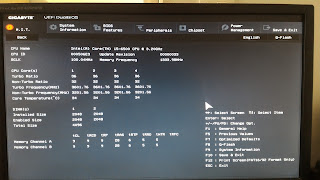Dans l'optique d'expliquer ce qu'est le cloud computing ou "informatique dans les nuages", il nous faut comprendre les problèmes auquel répond cette forme d'informatique, et nous avons commencé à aborder ceci dans cet article sur la haute disponibilité ; nous allons en dire un peu plus encore.
Mais il est temps d'en dire un peu plus sur les technologies de virtualisation qui sont à la base d'une partie importante de cette nouvelle forme d'informatique.
Qu'est ce que la virtualisation
L'informatique est, à la base, une forme de virtualisation de la réalité : les logiciels divers et variés ne font que rendre immatériels sous une forme numérique (c'est à dire constituée de 0 et de 1) les artefacts du monde réel : fichiers de traitement de texte vs manuscrits, images numériques vs photographie argentique, email vs courrier etc.
Le plus souvent l'informatique ne créé rien dans un premier temps mais reproduit avec ses moyens les activités humaines ; puis s'appuie dans un second temps sur ses capacités de traitement dé-multipliables à l'infini pour dégager de nouvelles façons de faire, de nouveaux "usages" comme on aime dire.
Ce recours à l'informatique est sans cesse croissant depuis 2 ou 3 décennies et ne fait que s'accélérer. On assiste à une transformation en profondeur des usages de l'informatique qui pénètre tous les domaines. On entend souvent le terme de '"digitalisation" (ou encore plus pédant : transformation digitale) qui est une très mauvaise traduction de l'anglais et n'a en fait pas grand sens au niveau étymologique. Mais c'est le terme consacré ; c'est ainsi, le marketing a encore frappé.
Le plus souvent l'informatique ne créé rien dans un premier temps mais reproduit avec ses moyens les activités humaines ; puis s'appuie dans un second temps sur ses capacités de traitement dé-multipliables à l'infini pour dégager de nouvelles façons de faire, de nouveaux "usages" comme on aime dire.
Ce recours à l'informatique est sans cesse croissant depuis 2 ou 3 décennies et ne fait que s'accélérer. On assiste à une transformation en profondeur des usages de l'informatique qui pénètre tous les domaines. On entend souvent le terme de '"digitalisation" (ou encore plus pédant : transformation digitale) qui est une très mauvaise traduction de l'anglais et n'a en fait pas grand sens au niveau étymologique. Mais c'est le terme consacré ; c'est ainsi, le marketing a encore frappé.
Les systèmes de virtualisation ce sont donc simplement des logiciels qui permettent de simuler le fonctionnement d'un ordinateur avec l'ensemble de ses composants matériels, son système d'exploitation, les logiciels qui y sont installés, et les données qu'il stocke sur ses périphériques de stockage (disque dur).
La forme virtuelle d'un ordinateur prend donc la forme d'un fichier (ou d'une série de fichiers) qui nécessite pour être exploité un logiciel spécifique. Comme un document Word nécessite le traitement de texte du même nom, un fichier Excel le tableur du même nom, une vidéo un player vidéo sachant en exploiter le format etc.
Les logiciels qui permettent de créer des ordinateurs virtuels proposent une interface qui permet de décrire l'ordinateur qu'on veut virtualiser : architecture processeur, nombre de coeurs du processeur, quantité de mémoire, type de firmware (bios ou uefi), taille du disque etc.
Les logiciels qui permettent d'exploiter ces ordinateurs virtuels permettent de les démarrer, comme on le ferait en appuyant sur l'interrupteur d'un vrai PC, de les éteindre, de les rebooter (bouton reset) etc...
Une fois un ordinateur virtuel démarré, la première chose à faire est d'y installer un système d'exploitation, comme on le ferait pour un vrai ordinateur, puis ensuite on l'utilise comme un vrai : installation de logiciels, utilisation des logiciels etc.
Et cette capacité de virtualisation a permis l'essor de nouveaux usages au fur et à mesure qu'on s'est familiarisé avec l'idée et qu'on a pris conscience des possibilités nouvelles qu'elle offrait.
A partir d'ici nous utiliserons l'acronyme VM (Virtual Machine) pour désigner une machine virtuelle.
A partir d'ici nous utiliserons l'acronyme VM (Virtual Machine) pour désigner une machine virtuelle.
Deux types de logiciel de virtualisation
On appelle hyperviseur un système de virtualisation.
Le premier type de système de virtualisation est constitué d'applications qui s'installent et s'exécutent sur un système d'exploitation, de la même façon qu'un navigateur, un traitement de texte ou tout autre logiciel auquel vous êtes accoutumés.
Les produits les plus connus sont probablement Workstation Player (de la société VMWare), VirtualBox (de la société Oracle, anciennement Sun) mais il en existe d'autres. Ces produits sont gratuits, ils se téléchargent et s'installent simplement en quelques minutes.
Le second type de système de virtualisation est constitué d'un système d'exploitation dédié qui s'installe donc sur un ordinateur physique, ou d'un service optionnel fourni par un système d'exploitation traditionnel.
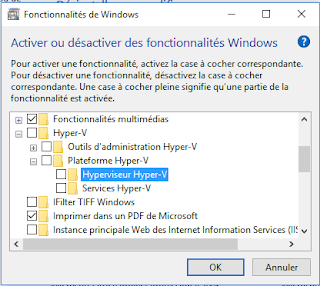 |
| Activation de Hyper-V sous Windows |
Les produits les plus connus sont probablement ESX de la société VMWare (qui est leader dans le secteur et a largement contribué par ses produits à la large adoption de la virtualisation), KVM (solution open source basée sur le noyau Linux et soutenue par Red Hat) et Hyper-V (Microsoft, anciennement Virtual PC), mais il en existe d'autres.
Ces produits sont disponibles gratuitement en open source ou soumis à licence.
Les logiciels de virtualisation s'appuient pour plus de performance sur des jeux d'instructions supplémentaires fournis par la majorité des processeurs ; cependant, des versions bas de gamme de processeurs peuvent en être dépourvues (point d'attention à avoir pour choisir un processeur si on prévoit de faire de la virtualisation).
Comment ça fonctionne ?
Loin de nous l'idée d'expliquer en détail le fonctionnement d'un hyperviseur, nous nous contenterons de brosser un tableau général.
Tout d'abord, il faut avoir en tête qu'en informatique, tout est architecturé en couches successives : chaque couche s'appuie sur la couche immédiatement inférieure qui lui expose les services dont elle a besoin, et n'a connaissance que de cette couche.
Chaque couche constitue une couche d'abstraction pour la couche supérieure : elle est là pour lui masquer la complexité des problèmes qu'elle gère.
La couche supérieure exploite donc les services et s'en sert elle même pour faire son propre job et fournir à son tour des services à sa couche supérieure (a qui elle épargne les détails de mise en oeuvre) etc.
Prenons un exemple approximatif mais réaliste. Le micro-contrôleur (couche 1) d'un disque dur masque l'utilisation des moteurs et autres éléments mécaniques au driver (couche 2). Le driver (ou pilote) masque les spécificités de chaque modèle de disque dur en fournissant une interface commune à tous les modèles au système d'exploitation (couche 3). Le système d'exploitation fournit une API bas niveau aux applications qui ont ainsi la possibilité de lire et écrire des fichiers Certaines applications, comme l'interpréteur d'un langage interprété constituent une 4éme couche et fournissent des instructions pour les programmeurs qui vont pouvoir écrire des programmes destinés cette fois ci à des êtres humains, qui constituent la dernière couche. Et encore on pourrait imaginer une couche de techniciens spécialisés manipulant les programmes pour fournir un service à des donneurs d'ordre, eux mêmes prestataires consommant les résultats ainsi obtenus pour les agréger avec d'autres sources d'informations et constituant ainsi une nouvelle couche vis à vis d'un consommateur final : et ici encore on se rend compte que cette organisation en couche n'est une fois de plus qu'une reproduction des activités humaines.
Un système d'exploitation hébergé par un ordinateur virtuel croit parler à la couche matérielle (par l'intermédiaire d'un pilote en général) mais en fait une couche est intercalée : l'hyperviseur.
Il se charge de faire le lien avec la couche inférieure (le vrai matériel) mais il en profite pour jouer son rôle, par exemple en arbitrant l'utilisation des ressources réelles de la machine entre plusieurs VM.
Il se charge de faire le lien avec la couche inférieure (le vrai matériel) mais il en profite pour jouer son rôle, par exemple en arbitrant l'utilisation des ressources réelles de la machine entre plusieurs VM.
Donc au final, on a un hyperviseur qui se fait passer pour le matériel. Le système d'exploitation virtualisé fonctionne de la façon habituelle mais au lieu de parler avec le matériel d'un ordinateur sur lequel il serait installé, il parle avec l'hyperviseur.
Ce qu'il est primordial de comprendre, c'est que pour la VM c'est totalement transparent : le système d'exploitation n'a aucunement conscience d'être virtualisé.
A quoi ça sert ?
Il y a de nombreux usages, et probablement d'autres à inventer, nous en citons quelques un, à commencer par les plus basiques et les plus évidents.
Pouvoir disposer simplement et à moindre coût d'environnements multiples
La virtualisation permet de disposer d'une multitude de configurations de façon simple. Si on a besoin d'avoir des ordinateurs sous différentes versions de Windows, Linux, Mac OS, ou avec différentes architectures processeurs, on n'a plus besoin d'avoir 1000 m2 d'entrepôt pour stocker tous ces matériels. Il faut juste un bon disque dur pour stocker les machines virtuelles : ben oui, ce n'est plus du matériel mais une virtualisation de matériel.
Au delà du côté pratique, il y a un côté financier : le matériel n'est pas gratuit. Les solutions de virtualisation non plus mais c'est quand même beaucoup moins cher.
Et pourquoi aurait on besoin de tout ce matériel toutes ces configurations ? Hé bien par exemple car on développe un logiciel utilisé par des gens qui ont toutes sortes de matériels et d'OS différents. Et il nous faut tester notre logiciel sur chaque plateforme. Egalement, la compilation du produit final ne peut parfois se faire que sur la plateforme cible.
Bien sur, on peut virtualiser autre chose que des ordinateurs ; au hasard et par exemple, les smartphones. Il existe des dizaines de modèles, il n'est guère réaliste de devoir tous les posséder pour faire des tests d'un logiciel pour mobile. Idem pour les tablettes.
Pouvoir disposer rapidement d'un environnement
Cas de figure : vous signez un contrat avec un client pour développer une application. Il s'agit d'une application qui s'exécutera à terme sur un serveur dans l'environnement du client.
Pour vos tests, vous devez disposer d'une plateforme serveur identique, ou la plus proche possible, de la cible (de celle de votre client). Vous n'en disposez pas nécessairement. Et en admettant que vous en disposiez, elle n'est sans doute pas disponible.
Sans virtualisation, il faudrait commander un serveur chez un fournisseur, il y aurait un coût qui viendrait manger votre marge, et il y aurait surtout un délai de livraison. Or, les délais sont toujours insuffisants et on n'a pas de temps à perdre. Grâce à la virtualisation, la machine virtuelle est créé en quelques minutes (le plus long sera l'installation et le paramétrage de l'OS et des éventuels pré-requis).
Quelles opportunités encore ?
La consolidation des serveurs
Ce point est particulièrement mis en avant par le sociétés qui vendent des solutions de virtualisation.
Il faut savoir que de façon générale, les entreprises dimensionnent le matériel qui héberge une application serveur en fonction de l'activité maximale dudit logiciel. Et c'est bien logique, il s'agit que le système ne s'effondre pas en période de pic d'activité.
Mais du coup, si les pics n'ont lieu que 10% du temps, pendant 90 % du temps le matériel n'est exploité que pour une faible part de ses capacités. Il y a donc du gâchis, d'autant que comme il est très délicat de dimensionner une infrastructure et qu'on ne veut pas prendre de risque, on a tendance à tailler large.
La consolidation consiste à virtualiser les environnements serveurs et à les regrouper sur une machine physique chargé de les faire tourner (un serveur de VM).
Il s'agit d'une machine puissante et coûteuse, mais beaucoup moins que la somme des serveurs utilisés dans la situation initiale. Comme les VM n'ont pas toutes un pic d'activité en même temps, tout fonctionne (en théorie).
La consolidation de n VM sur un seul serveur a bien sur des limites, on ne peut pas ajouter éternellement des VM sur un seul serveur, il y aura toujours un moment où la somme des besoins de l'ensemble des VM, hors période de pic, dépassera les capacités du serveur. Et il y aura toujours le risque que plusieurs VM aient des pics d'activité simultanés, le risque augmentant de façon statistique avec l'augmentation du nombre de VM sur un même serveur de VM.
Mais les éditeurs ont des solutions à ça : on peut multiplier les serveurs physiques, et mieux encore équilibrer automatiquement la charge des différents serveurs en déplaçant les VM d'un serveur à l'autre, de façon transparente pour les utilisateurs. Et qui plus est de façon dynamique (c'est à dire au moment même ou "on" va se rendre compte qu'un serveur atteint ses limites, le "on" étant ici encore une sonde logicielle ou matérielle).
Comme bien souvent avec les solutions gratuites, il faut passer par une version payante dite "enterprise" ou "advanced", ou encore par un contrat de support payant, pour pouvoir tirer la quintessence de ces solutions : il faut bien que les éditeurs gagnent de l'argent quelque part pour financer les coûts de développement (et bien sur dégager des marges pour leur pauvres actionnaires).
Les entreprises avec des petits moyens et/ou des petits besoins peuvent tout à fait se contenter des solutions gratuites.
Par contre, si la technologie est adoptée (et c'est généralement le cas car elle a de nombreux avantages), il arrive un moment où inévitablement le recours aux solutions payantes est obligatoire. Et là, le piège se referme... coûts de licences, options innombrables et incompréhensibles, bref les éditeurs dont c'est le métier savent bien tirer le maximum de profit de la bête.
L'alternative est le recours aux solutions open-source. Plus de licence, mais les coûts se situent ailleurs, car il faut recourir à des ressources humaines (des ingénieurs spécialisés en gros) qui d'un part ne courent pas les rues, et d'autres part sont onéreuses. Cette option reste cependant très intéressante pour peu qu'on sache se faire conseiller et qu'on dispose du réseau adéquat.
Parenthèse : la stratégie des éditeurs de solutions de virtualisation
Il existe des solutions de virtualisation qui sont disponibles gratuitement dans des versions "basiques" (en fait toutes je suppose) : elles offrent le service de virtualisation (voire un peu plus) et c'est tout. Il faut se débrouiller ensuite avec le problème de répartition des VM entre serveurs de VM, et plus généralement avec toutes les problématiques liées à l'exploitation de ces infrastructures (supervision, sauvegardes etc.).Comme bien souvent avec les solutions gratuites, il faut passer par une version payante dite "enterprise" ou "advanced", ou encore par un contrat de support payant, pour pouvoir tirer la quintessence de ces solutions : il faut bien que les éditeurs gagnent de l'argent quelque part pour financer les coûts de développement (et bien sur dégager des marges pour leur pauvres actionnaires).
Les entreprises avec des petits moyens et/ou des petits besoins peuvent tout à fait se contenter des solutions gratuites.
Par contre, si la technologie est adoptée (et c'est généralement le cas car elle a de nombreux avantages), il arrive un moment où inévitablement le recours aux solutions payantes est obligatoire. Et là, le piège se referme... coûts de licences, options innombrables et incompréhensibles, bref les éditeurs dont c'est le métier savent bien tirer le maximum de profit de la bête.
L'alternative est le recours aux solutions open-source. Plus de licence, mais les coûts se situent ailleurs, car il faut recourir à des ressources humaines (des ingénieurs spécialisés en gros) qui d'un part ne courent pas les rues, et d'autres part sont onéreuses. Cette option reste cependant très intéressante pour peu qu'on sache se faire conseiller et qu'on dispose du réseau adéquat.
La Haute Disponibilité
Si vous n'avez pas les idées claires sur le sujet, ce premier article vous donnera le contexte.
La redondance d'une VM est aisée à obtenir puisqu'il suffit de dupliquer une VM pour multiplier le nombre d'instances.
Même sanction pour la scalabilité horizontale : si on veut paralléliser sur une machine supplémentaire, il suffit de dupliquer une VM et de la mettre en place derrière le répartiteur de charge, tout ceci n'est que de la manipulation de fichier et peut donc s'automatiser.
Et avec la flexibilité qu'apporte la virtualisation, on peut envisager un mécanisme autonome et automatique qui ajuste le nombre de VM en fonction de la charge : la fameuse élasticité. Tout ce qu'il nous faut est un programme qui sache créer automatiquement des VM, et le coupler avec les sondes qui surveillent la charge de nos serveurs de VM (plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée de base est simple).
Tout ça est bien beau mais c'est désormais le serveur de VM qui constitue un SPOF. Ici, il faudra passer par l'achat de plusieurs serveurs, et des solutions logicielles ou matérielles commercialisées par les éditeurs.
Et si on veut bien faire, une fois le serveur de VM redondé, il faudra redonder l'espace disque partagé (SAN, NAS, baie de disque dédiée ...), puis les équipements réseau, puis les réseaux d'alimentation électrique, puis les onduleurs, puis les groupes électrogènes, puis les datacenter proprement dits etc... C'est pourquoi on fait généralement appel à des sociétés d'hébergement spécialisées qui mutualisent le coût énorme de tous ces investissement entre une multitude de clients.
Et si on veut bien faire, une fois le serveur de VM redondé, il faudra redonder l'espace disque partagé (SAN, NAS, baie de disque dédiée ...), puis les équipements réseau, puis les réseaux d'alimentation électrique, puis les onduleurs, puis les groupes électrogènes, puis les datacenter proprement dits etc... C'est pourquoi on fait généralement appel à des sociétés d'hébergement spécialisées qui mutualisent le coût énorme de tous ces investissement entre une multitude de clients.
La gestion de configuration automatisée
Etant donné que les ordinateurs sont virtualisés, ils peuvent être crées et manipulés de façon automatique par des programmes (ben oui, un ordinateur virtuel c'est juste un fichier). Et l'air de rien ça ouvre des multitudes de possibilités.
En informatique, la gestion de configuration est une discipline très importante : elle consiste à être capable de garder la trace d'un environnement informatique et de le reproduire à l'identique en cas de besoin, même plusieurs mois après.
Il faut être conscient qu'installer un environnement informatique peut être une opération lourde et complexe demandant parfois plusieurs jours entre l'installation du système, sa configuration selon des règles précises, le passage de patchs correctifs à un certain niveau, l'installation de différents applicatifs serveurs, leur configuration, le passage de patchs (encore), l'installation d'applications, leur configuration etc. Qu'une seule opération diffère et l'environnement final diffère, avec potentiellement des impacts.
Un syndrome courant en informatique est "ça marche sur ma machine" : un programme fonctionne sur la machine du développeur, ou le serveur de test, et dysfonctionne sur son environnement de production. La raison en est souvent une différence entre les environnements. En s'assurant que tout le monde travaille sur le même environnement, on élimine ces problèmes.
Inutile de dire qu'un processus manuel est source d'erreur, et en outre inintéressant dans un environnement virtualisé : ça ne sert à rien d'automatiser la création d'ordinateurs virtuels si on n'est pas capable d'automatiser toute la chaîne.
Un syndrome courant en informatique est "ça marche sur ma machine" : un programme fonctionne sur la machine du développeur, ou le serveur de test, et dysfonctionne sur son environnement de production. La raison en est souvent une différence entre les environnements. En s'assurant que tout le monde travaille sur le même environnement, on élimine ces problèmes.
Inutile de dire qu'un processus manuel est source d'erreur, et en outre inintéressant dans un environnement virtualisé : ça ne sert à rien d'automatiser la création d'ordinateurs virtuels si on n'est pas capable d'automatiser toute la chaîne.
La virtualisation permet déjà par simple manipulation de fichier de reproduire des machines à l'identique, mais cette façon de faire que nous avons évoquée jusque présent a des limites.
Mais, il existe tout un ensemble de logiciels spécialisés qui savent créer automatiquement des VM et y installer des logiciels selon un plan précis (on parle de provisioning).
Mais, il existe tout un ensemble de logiciels spécialisés qui savent créer automatiquement des VM et y installer des logiciels selon un plan précis (on parle de provisioning).
Ce sujet est actuellement en plein développement avec des solutions comme Vagrant, Chef, Puppet, Ansible, Docker ... On rejoint ici une des thématique du mouvement DevOps dont nous parlerons dans un autre article.
Cloud privé, Cloud public
Cloud privé
On appelle "Cloud privé" une infrastructure de virtualisation avancée, avec toutes les fonctionnalités évoquées plus haut pour le support de la haute disponibilité (redondance des serveurs de VM, équilibrage de la charge des serveurs de VM par répartition dynamique des VM entre serveurs, et plus si affinité) déployée dans un le centre informatique privé d'une entreprise.Mais je comprends plus rien : on me dis qu'on parle de Cloud car c'est une forme d'informatique basée sur Internet, et là on parle de cloud privé et il n'y a aucun lien avec Internet... C'est le problème avec le jargon marketing, il n'a pas de sémantique précise, chacun met ce qu'il veut derrière, et ça change selon le sens du vent. Décryptons.
On utilise le terme Cloud privé par opposition au Cloud public qui lui est bien basé sur l'utilisation d'Internet.
En fait, les infrastructures et les logiciels qui permettent de mettre en place, et d'exploiter facilement, une infrastructure de virtualisation ont d'abord été développées pour un usage interne par des sociétés novatrices, qui les ont ensuite commercialisées : ce fut l'émergence d'une forme particulière de cloud public (au sens d'un modèle économique basé sur la mise à disposition de ressources en location sur Internet) appelé IAAS (expliqué plus bas).
Puis ces solutions se sont répandues et des entreprises ont fait le choix de les déployer au sein de leurs propres centres informatiques (aka datacenter). Dès lors, il n'y a plus de lien avec Internet mais comme c'est la même technologie que celle utilisée par le acteurs du Cloud Public pour leurs offres IAAS, on a appelé ça Cloud Privé.
Cloud public
L'économie du Cloud prend plusieurs formes dont une au moins est directement liée à l'essor des techniques de virtualisation : IAAS (Infrastructure As A Service).
Le principe est de commercialiser la mise à disposition de machines virtuelles qui s'exécutent sur des serveurs de VM qui sont externes à l'entreprise et hébergés "quelque part" sur Internet (donc dans le Cloud), selon un modèle de facturation à l'usage.
Le client loue de la puissance de traitement rendue disponible grâce à Internet, et ne se soucie plus de toute l'infrastructure requise pour disposer des avantages les plus avancés procurés par la virtualisation (haute disponibilité, ajustement automatique des capacités, et donc des coûts, en fonction des besoins, automatisation des opérations poussée au maximum).
Contrairement au "Cloud privé" l'entreprise est déchargée de la gestion de l'infrastructure de virtualisation et de l'exploitation de la plateforme (par contre, ses données sont hors de ses murs ce qui peut être un vrai souci).
Nous détaillerons les différents formes que prend le cloud computing dans un prochain article
Le client loue de la puissance de traitement rendue disponible grâce à Internet, et ne se soucie plus de toute l'infrastructure requise pour disposer des avantages les plus avancés procurés par la virtualisation (haute disponibilité, ajustement automatique des capacités, et donc des coûts, en fonction des besoins, automatisation des opérations poussée au maximum).
Contrairement au "Cloud privé" l'entreprise est déchargée de la gestion de l'infrastructure de virtualisation et de l'exploitation de la plateforme (par contre, ses données sont hors de ses murs ce qui peut être un vrai souci).
Nous détaillerons les différents formes que prend le cloud computing dans un prochain article
Conclusion
Le premier article sur la haute disponibilité visait à préparer vos esprits aux avantages apportés par la virtualisation en la matière.Ce second article sur la virtualisation vous fait toucher du doigt l'intérêt qu'il peut y avoir a s'appuyer sur un modèle de consommation de ressources virtualisées via Internet (IAAS).
Le prochain article en dira un peu plus sur ce point, et détaillera les autres formes que prend le cloud computing (SAAS, PAAS, DAAS).